Traduction : Salut à vous , Eglise de ma paroisse !!
 La splendeur de nos cantiques bretons n’est plus à démontrer. Ils appartiennent au patrimoine religieux de notre pays. Hélas, trop souvent un patrimoine, sinon méprisé, certainement bien oublié par ceux-là même qui auraient dû être les premiers à le défendre. C’est plus que dommage car c’est en quelque sorte un assassinat culturel et spirituel.
La splendeur de nos cantiques bretons n’est plus à démontrer. Ils appartiennent au patrimoine religieux de notre pays. Hélas, trop souvent un patrimoine, sinon méprisé, certainement bien oublié par ceux-là même qui auraient dû être les premiers à le défendre. C’est plus que dommage car c’est en quelque sorte un assassinat culturel et spirituel.
Culturel, car musicalement, nos cantiques relèvent d’un mode musical unique, propre à la Bretagne. Nombre de ces airs on d’ailleurs été empruntés au Barzaz Breizh, le clergé ayant christianisé ses airs. Précisons tout de suite pour rassurer les esprits chagrins qui seraient prêts à crier au pillage, que cette christianisation n’enlève rien à l’originalité des chants profanes, et n’altèrent nullement la pureté des cantiques qui en découlent. Personnellement, je n’ai jamais été choqué de chanter « Mari hor Mamm Garantezuz » (Marie, notre mère chérie) sur l’air de Pennerez Keroulaz, ou le Notre Père en breton sur l’air de Silvestrig.
Spirituellement, car les textes de nos cantiques sont un étonnant et fidèle raccourci de la théologie de l’enseignement divin, que ce soit pour les jours de fêtes liturgiques, patronales, les sacrements, la vie chrétienne, en l’honneur de Dieu, de la Vierge Marie ou des défunts. Le mysticisme des Bretons s’y dévoile avec une extrême pudeur.
Dans la présentation d’un beau disque, quelques célèbres cantiques « Kanaouennoù santél » chantés par Anne Auffret, Claudine Mazéas le dit fort bien : « Si la sensibilité bretonne s’accommode d’une certaine naïveté primitive qui pourrait sembler dépassée à première vue, on s’aperçoit que sous une écorce rude se cache une vérité théologique à la portée des gens les plus simples, et toujours actuelle ».
Il y a une époque pas si lointaine où nos paysans chantaient par coeur ces cantiques, tout comme le grégorien. Les anciens missels paroissiens, uniquement en breton et en latin, témoignent de la place privilégiée qu’avait notre langue à l’église. En 1961, juste avant le grand chambardement liturgique consécutif à une mauvaise interprétation des réformes conciliaires, fut enregistré à Plésidy (Côtes d’Armor) un disque très vivant de la messe paroissiale de Pâques. Enregistré sur le vif, on peut entendre les paroissiens chanter à pleine voix les cantiques populaires bretons, mais aussi les hymnes grégoriens de Pâques, comme le Victimae Paschali laudes et la messe royale de Dumont. Les voix des hommes et des femmes s’alternent harmonieusement comme il était d’usage, même si ce sont des voix paysannes et non d’une chorale. C’était ainsi que l’on chantait dans toutes les paroisses, où le plain-chant, le grégorien, le breton faisaient bon ménage, offrant ainsi à Dieu, à Marie et à tous les saints de Bretagne, des couronnes de gloire.
Qu’en est-il aujourd’hui, là où le clergé et les équipes paroissiales débretonnisées ignorent complètement ce que peut être ce riche patrimoine spirituel non transmis ?
NDLR : nous publions une partie de cet article, issu du Kannadig AR GEDOUR N° 10, non dans un but de remuer le passé et d’évoquer une certaine nostalgie, mais dans une volonté de poser des questions essentielles dans la pastorale bretonne. L’inculturation prônée par Jean Paul II et Benoît XVI n’est pas uniquement valable pour d’autres cultures, mais aussi pour nous, bretons. Un ancrage dans la culture locale est la meilleure façon de pérenniser et de développer une foi à l’expression ancienne. Nous y reviendrons par la suite. D’ores et déjà, voici ici la première partie de cette chronique.
La deuxième partie est accessible ici.
(Rediffusion d’un billet du 10/10/2011)
 Ar Gedour Actualité spirituelle et culturelle de Bretagne
Ar Gedour Actualité spirituelle et culturelle de Bretagne



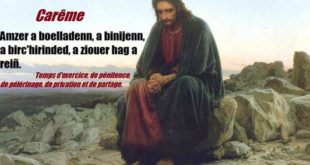

Un commentaire
Pingback : A PROPOS DU « DA FEIZ HON TADOU KOZ » - Ar Gedour